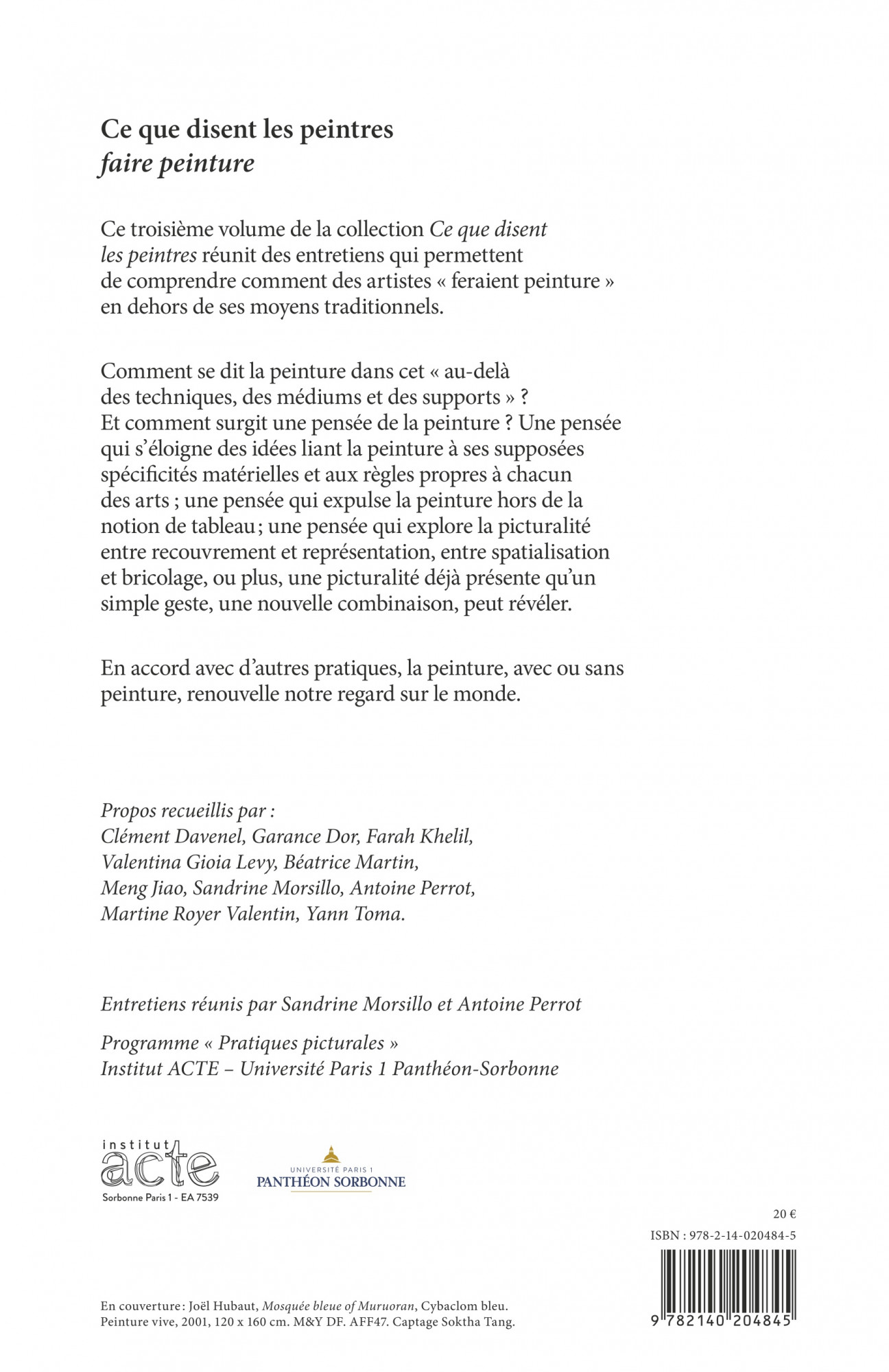Les œuvres d’Isabelle Ferreira renvoient à la peinture sans en être tout à fait cependant. Des papiers peints déchirés et agrafés, des plaques de contreplaqué brisées, d’autres creusées à coups de marteau, des briques assemblées ainsi que des mobiliers et étagères sur lesquels sont positionnés des volumes, des objets constitués de matériaux divers, déjà colorés ou recouverts d’aplats de couleurs qui font écho à la peinture minimaliste, au Bauhaus par leur composition et leur rapport aux couleurs. Les installations d’Isabelle Ferreira oscillent ainsi entre peinture et sculpture et ouvrent à une large gamme de matériaux liés à la construction et à l’ameublement sans que l’on puisse vraiment situer son travail dans un domaine plus que dans un autre. Dans l’atelier mon œil s’est arrêté plusieurs fois sur des matériaux simplement rassemblés que je ne pouvais m’empêcher de rapprocher d’assemblages tant le jeu est subtil entre l’élément simplement posé, déposé et l’élément composé ou disposé. Il y aurait là tout à la fois un art de l’exposition, une peinture d’exposition, et une forme de peinture en volume faite par la mise en espace d’éléments divers ou par des matériaux travaillés dans leur relief, simplement.
Vous considérez-vous comme peintre ? Quel est votre rapport à la peinture ?
Dans un premier temps, j’ai eu envie de vous répondre que, non, je ne suis pas peintre pour des raisons plutôt liées à une perception très classique de ce que signifie être peintre. Non, aussi, parce que répondre par une définition trop affirmée de mon rapport à la peinture m’enferme dans l’appréhension que je peux avoir de mon propre travail, je n’aime pas les pensées trop dogmatiques. Définir son territoire c’est important, pouvoir le circonscrire également, mais je ne veux pas être dans une parole trop définitive afin de permettre à mes gestes de se rejouer à tout moment et indéfiniment.
Cela étant dit, dans mon travail il me semble que la peinture est partout. Même si je pense que chez moi la question de la couleur est plus efficiente et souveraine que la peinture elle-même. Peindre avec de la peinture ne suffit pas à faire de la peinture. J’ai un rapport pratique à celle-ci. Je m’en sers comme un outil, un moyen de la couleur, d'ailleurs je n'emploie quasiment que de la peinture industrielle. Cette dernière me permet d'aller vite en créant un rapport très direct au dépôt. Pas de mélange, pas de tambouille, pas de palette. Souvent, on pourrait même dire que c’est plutôt de la poussière de peinture conditionnée en bombe que de la matière.
J’aime beaucoup ce moment où la peinture commence à recouvrir le support, le temps présent qu’elle convoque et la tension qu'elle occasionne. Je la dépose en une seule fois car je veux aussi limiter le côté sensuel et virtuose de l’acte de peindre. Il faut que le processus soit rapide pour répondre à une situation plastique donnée que je perçois souvent comme une urgence. Quand je peins je suis vraiment à ce que je fais car souvent je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux rien effacer. Pour moi peindre, c’est donc assumer le face à face que l’acte de peindre impose et c’est surtout le geste qui va orienter le résultat, s'il est maladroit, non senti, je peux aller jusqu’à perdre ma pièce. C’est un risque. Dans mon travail, le geste vient avant le fait de considérer que je suis dans un médium ou dans un autre. Lorsque je fais des pièces avec un arrache-clou (Subtraction), c'est un geste de sculpteur qui est réalisé par soustraction comme si je donnais des coups de pinceaux en négatif alors que je creuse dans le bois. J'ai certes des préoccupations picturales classiques liées à la surface, au dépôt, à la planéité, à l’organisation et à la vibration des couleurs entre elles, mais je n'y réponds pas forcément avec les outils du peintre.
Je dois cependant dire que j'ai gardé un grand amour de la peinture et que je regarde aussi avec beaucoup d’intérêt le travail des peintres. Et c’est sans doute la réminiscence de la période où je peignais sur châssis qui infère à ma production d’être souvent accrochée aux murs.
J'ai lu un article dans lequel vous affirmiez que votre travail avait véritablement commencé quand vous aviez cessé de peindre. Pouvez-vous revenir sur cet arrêt ? Quel sens prend-il dans votre pratique ?
J’avais énoncé les choses de cette manière pour expliquer comment j'étais arrivée à la sculpture après ma formation aux Beaux-arts. Avant cela, j'étais passée par les ateliers Glacière où je ne faisais pratiquement que de la peinture. Au départ, comme beaucoup d'apprentis artistes, je peignais des formes abstraites, expressionnistes, aux couleurs bigarrées. J’ai mis des années à comprendre que ce n'était pas mon médium, en tout cas que peindre sur une toile ne me convenait pas. J’ai donc arrêté la peinture dans ce contexte de prise de conscience aigüe. J’étais dans une impasse. À partir de ce moment, j’ai plutôt envisagé de travailler en regardant et en considérant autrement l'espace autour de moi. Cela s’est fait assez naturellement. Le travail a glissé simplement d’une façon de faire vers une autre. D’un moyen vers un autre. C’est pour ça que j’évoque souvent la lisière entre les médiums. Des choses continuent d’être en contact, de se toucher. De nouvelles thématiques sont apparues, le support qui se situe sous la couleur, l’espace entre le support et le mur, la "fenêtre ouverte" albertienne, le mur lui-même. Parmi mes premières pièces figurent Sculpture pour une image ou Tableau de 8 minutes dont les titres et ce qui s’y joue évoquent bien cet intérêt pour des dispositifs se situant entre deux médiums.
Le support a beaucoup d’importance dans votre travail. Revenons au contreplaqué que vous utilisez dans différentes pièces, il se produit un effet intéressant quand vous le brisez ou quand vous en retirez une couche, puisqu’il s’y forme des motifs par soustraction. Il est à la fois un support, un médium et une matière.
Le contreplaqué est arrivé dans ma pratique à un moment où j’interrogeais l’économie du support et la confrontation de mes gestes à ce support. Au même titre que les briques plâtrières ou les feuilles de papier A4, les panneaux de bois industriel sont des matériaux humbles qui me permettent à la fois d’interroger la surface, l’épaisseur et la matière. Dans les Subtractions (2013/2021), les touches visibles sont le fruit d’un geste répété des centaines de fois. Je frappe, je taille avec mon arrache-clou et creuse dans le contreplaqué. Quand j’arrive aux strates plus claires, c’est-à-dire à la partie centrale du bois qu’on appelle « l’âme », je fais alors apparaître les plis du bois, les différentes couches liées à sa fabrication.
Le contreplaqué me permet d’avoir un rapport à l'œuvre très physique. Le support est selon les endroits de la frappe plus ou moins rigide, parfois il rebondit, parfois j’ai l’impression de frapper dans un mur. Pour obtenir les formes que je veux, le geste doit être précis et radical. C'est un geste énergique et déterminé qui contraste avec le résultat obtenu. Il pourrait conduire à la destruction du support, mais au final c’est par la précision de ce geste que j’arrive à renverser les qualités d’un matériau qui en est a priori dépourvu. Il y a une forme d’illusionnisme. On m’a souvent dit des Subtractions qu’elles ressemblaient à de la broderie, du velours ou à du tissu moiré, alors que prosaïquement il s’agit de planches de contreplaqué défoncées au marteau. Je désactive donc la fonction originelle du support pour en faire une nouvelle matière. C’est l’accumulation du même geste avec quelques variations d’intensité qui va finir par produire un résultat pictural.
Finalement ne travaillez-vous pas avec des matériaux qui contredisent la planéité de la peinture ? Par ailleurs, pourrait-on parler d’un geste de graveur puisqu’il y a une soustraction de la matière ?
On pourrait peut-être assimiler mes gestes à celui d’un graveur lorsque je creuse vers l’intérieur d’une planche, mais mes gestes et mes mouvements sont peut-être plus amples et nécessitent plus d’espace et d’énergie pour se déployer. Il y a aussi un hasard plus grand car la matière ne s’enlève pas toujours à l’endroit voulu. Ce sont donc à mon sens plutôt les gestes que les matériaux qui contredisent la planéité de la peinture. Les papiers déchirés (Pétales ou Staccato) bien qu’ils soient peints en aplats ne sont pas dans cette idée de la planéité. Dans les Staccato, lorsque je pose mes feuilles peintes contre le mur, que je les agrafe avant de les arracher d’un grand geste, c’est bien la déchirure qui ôte à la peinture sa planéité pure. Ce qui m’intéresse c'est plutôt l’épaisseur des matériaux ou l’excavation du support, comme dans les œuvres de la série Wall box (2012), dans lesquelles j’ai enfermé de la peinture entre deux plaques de contreplaqué avant d’aller la rechercher au marteau. Je fracture le premier plan pour faire apparaître la couleur peinte à l’intérieur. Ce qui m'intéresse dans ces œuvres plus anciennes c’est de trouver littéralement un geste pour aller chercher la couleur, comme pour la découvrir dans son épaisseur, plutôt comme un sculpteur que comme un graveur. Tout mon travail sur l’économie du geste et du support (déchirure, agrafage, action de trouer, frappe au marteau) est aussi pour moi l’occasion de réinterroger le vocabulaire traditionnel de la peinture et de la sculpture. Quand nous avons discuté pour préparer cet entretien nous avons beaucoup évoqué ces gestes… alors que je concluais que les artistes « faisaient tous des gestes », vous m’avez répondu que chez moi la spécificité était que les gestes se voyaient, qu’ils restaient visibles. Je ne me l’étais jamais formulé comme cela, mais c’est fondamentalement vrai.
Les Éléments de perspective ressemblent à du mobilier, des étagères de bibliothèques, et des peintures abstraites à la fois. Ces éléments-mobiliers rappellent les cadrages de Mondrian et contiennent des volumes qui apparaissent alors à travers leurs couleurs et leurs matières. D’ailleurs, dans votre atelier, j’hésite parfois entre une composition et ce qui pourrait être du stockage. En s’ouvrant à votre démarche on se laisse aller à apercevoir dans des matériaux rassemblés et simplement déposés une installation en germe.
Les Éléments de perspective pourraient en effet donner l'impression de vouloir jouer avec l’histoire et la grille moderniste, avec une peinture de Mondrian ou encore des sculptures minimalistes, comme les Furnitures de Donald Judd, bien sûr j’en ai volontairement repris les codes formels mais les enjeux de la série ne sont pas du tout les mêmes. Je fais appel à des codes plastiques ultra présents dans notre histoire contemporaine mais chez moi il y a surtout un va-et-vient assumé entre la capacité de cette œuvre à devenir soit peinture soit sculpture selon les modalités de son exposition. Deux états de monstration sont en effet possibles. Le premier forme un tableau accroché au mur dans lequel les éléments sont rangés au millimètre près et où rien n’est interchangeable ; le second dialogue davantage avec le lieu. Il y a donc un état de l’œuvre qui créée une image et un autre qui produit un volume. Pour moi ce sont des tableaux qui contiendraient tous les éléments nécessaires à une installation en trois dimensions, d’où ce terme d’« éléments » mis en perspective. Ce qui les distingue fondamentalement des œuvres de Judd aussi, c’est la nature et la destination des objets stockés. Les mobiliers contiennent une partie de mon vocabulaire avec sa dimension plus « artisanale » par rapport à des œuvres minimalistes. Les mobiliers sont à la fois des réservoirs de matériaux, de formes, de couleurs, de rebuts, où sont consignés une succession de gestes. Des morceaux de cuivre coupés, des surfaces peintes en aplats côtoient des racines recouvertes d’agrafes, des miniatures de pièces plus anciennes qui sont autant d’autocitations. Cela crée une sorte de condensé d’atelier. Le naturel y côtoie l’industriel : des bois trouvés dans la nature sont positionnés à côté de racines qui ont été acheté dans une boutique. Pour choisir ces éléments, je puise dans un stock personnel. Ce que vous voyez dans l’atelier est le résultat de plusieurs années d’accumulation de matériaux et d’objets divers, de glanage, de récupération. Pour moi, le stockage est déjà une forme du travail en soi. C’est le degré zéro d’une composition à venir qui porte en elle la charge et le potentiel d’œuvres futures, un peu comme s’il était chargé d’une force particulière à la manière des fétiches africains. Ce que je stocke dans l'atelier répond au départ à un besoin logistique de ranger pour gagner de la place, mais au final cela finit par infuser dans ma pratique, les espaces de stockage et les matériaux y sont presque aussi importants que les œuvres elles-mêmes.
Une fois hors du meuble, la disposition de ces pièces dans l’espace peut changer au cours de l’exposition. C’est un bel exemple de peinture qui sort du tableau. D’ailleurs le titre Éléments de perspective est annonciateur d’éléments dans la troisième dimension puisqu’en « perspective » ; ce serait donc une peinture occupant l’espace réel et non une représentation en perspective.
Éléments de perspective est une pièce complexe. Elle peut être présentée de différentes formes comme je vous le disais. Dans un premier temps, je définis une composition avec différents objets pour l’intérieur du mobilier. Cette composition donnée et originelle est toujours fixe. Mais dans un second temps, ces mêmes éléments peuvent prendre place hors du mobilier et être disposés dans l’espace. Ce geste étant généralement confié à la personne qui a la responsabilité de l’exposition de cette œuvre (commissaire, collectionneur, galeriste). C’est elle qui va décider de la forme finale de son déploiement en créant des liens entre les objets et de nouveaux récits entre les éléments. Elle peut aussi décider de ne rien sortir du mobilier et de laisser la composition picturale du départ accrochée au mur. Il y a certaines pièces dans mon travail qui sont liées à cette question du laisser-faire, de la non intervention. Ce qui m’intéresse c’est de mettre en place les conditions de réalisation d’une œuvre, avec des éléments à combiner à partir d’un contenu prédéterminé et d’ouvrir encore ses potentialités en confiant mes gestes à un autre. Cela donne des situations où la peinture cède sa place à des problématiques plus sculpturales. Où la surface peinte rangée dans le mobilier retrouve son statut de volume (voire même sa fonction de socle si on pose un élément dessus), ce qui était inopérant lorsqu’elle était rangée dans le mobilier. C’est aussi la réversibilité du geste qui m’importe. La capacité d’un contexte à se renouveler et à produire de nouvelles formes.
Comment composez-vous alors les objets dans le mobilier ?
Lorsque je sélectionne et mets en dialogue les objets sur une étagère, je pense aussi au moment où ils seront peut-être déployés dans l’espace. Les objets se complètent, dialoguent entre eux. La composition est faite sur un mode empirique et sensible : des aplats de couleurs, des matériaux de nature différentes réunis et où la distance et le rapport entre chaque élément est questionné. Au départ de ce projet – et c’est aussi de là qu’il tient son nom – il y a un traité de la fin du 18e siècle destiné aux jeunes peintres de Pierre-Henri de Valenciennes, Éléments de perspective pratique à l’usage des artistes, suivis de réflexions et conseils (1799). Dans cet ouvrage il est question de l’apparition de formes standardisés qui une fois utilisées et composées ensemble peuvent former un paysage. Il y donne tout un tas de conseils de composition pour l’étude et la « fabrication » d’une peinture de paysage. Les questions du hasard et de la combinatoire font leur apparition dans ces types de traités. Leurs méthodes d’invention et de création du paysage sont parfois très éloignées de l’expérience sensible de la nature. C’est la question de l’artificialité qui est en jeu, mais aussi de l’inventio de l’artiste qui se détache de l’imitation. Comme dans ce traité, la série Éléments de perspective permet d’agencer ensemble des éléments naturels et des éléments de construction artificiels pour former une proposition de paysage en volume. Elle convoque notre rapport physique à l’œuvre mais aussi la question du regard en continuant d’interroger la multiplicité du point de vue si chère à la sculpture.
D’ailleurs à propos de la question de l’exposition qui joue sur la peinture, la transforme, revenons à la série des Pétales. Ici l’exposition met en jeu la peinture. Ces morceaux de papier peints à l’acrylique, déchirés puis laissés libres dans leur cadre, entre deux verres, montrent une combinaison picturale sans cesse renouvelée car les mouvements de déplacement (transport, accrochage) jouent sur leur composition.
Il y a là encore une notion de jeu et de place laissée au hasard. Cette série cache derrière sa simplicité formelle une réponse possible au sujet du dialogue peinture/sculpture. Les Pétales reprennent d’ailleurs certains principes des Éléments de perspective : un contenant mural, du contenu stocké, de la couleur et la possibilité à la fois d’une composition fixe et d’une multitude d’autres combinaisons.
Les Pétales sont composés de fragments de papiers A4 que je peins à la bombe acrylique avant de les déchirer. Chaque feuille est au départ un monochrome recouvert de peinture. J’essaie de trouver le bon rapport entre la dimension des fragments de papier déchirés et leur masse colorée. Puis c’est un jeu de composition picturale qui se passe d’abord à l’extérieur du cadre : un peu de terre de Sienne, mélangé à un vert de chrome puis une surface de vert de vessie plus grande, un petit fragment d’orange fluo, du bleu de Prusse, du jaune de Naples, une pointe de noir, à nouveau du vert, deux ou trois différents, l’un tirant plus vers le jaune que les deux autres, du blanc mais pas trop… c’est comme cela que je travaille. C’est seulement dans un second temps que j’enferme les fragments à l’intérieur d’un cadre pour voir comment tout cela travaille ensemble. Quand la composition est prête je la donne à mon encadreur. La pièce n’existe vraiment qu’à partir de ce moment-là. Une fois encadrée. Mais il m’arrive parfois de devoir rouvrir des cadres pour ajouter ou enlever des fragments. Au moment de l’accrochage de la pièce dans une exposition, je fige une variation mais sa particularité c’est qu’elle pourra se rejouer indéfiniment à partir des éléments prédéfinis et présents à l’intérieur du cadre. J’ai aussi réalisé sur le même principe des diptyques, en enfermant dans deux cadres des fragments jumeaux provenant d’un même geste de déchirure. La question du double m’intéresse beaucoup.
Jouez-vous avec le mur d’exposition ? Comment ?
L’idée de continuité avec le mur de l'exposition s'affirme encore davantage dans les Staccato où le blanc du mur apparaît comme une réserve. Les fragments de papier qui restent agrafés composent une peinture qui semble se décoller du mur et dialoguer avec lui. On a l’impression que la peinture sort du cadre dans lequel on l'avait mise précédemment (Pétales). La question du cadre a d’ailleurs été longtemps l'une de mes préoccupations. Dans les Pétales, sa présence va même jusqu’à conditionner l’existence de l’œuvre elle-même. La plupart du temps il sert seulement à accrocher une pièce au mur, mais chez moi c’est le moyen de la réaliser. Et même quand le cadre est invisible et seulement suggéré comme dans les Staccato, il résiste aussi à disparaître complètement. En effet, chaque Staccato emprunte ses dimensions aux standards de l’Académie. Je choisis souvent le plus grand format de châssis : le 120P qui correspond donc à un paysage. Ce choix me permet de travailler avec de grandes lignes de force mais aussi de m’inscrire plus généralement dans une histoire de la peinture classique.
La distinction que je pourrai faire entre les séries Pétales et les Staccato soulignent exactement le point de bascule entre la présence du cadre (au sens de l’objet de la peinture classique) et la disparition de celui-ci au profit du mur lui-même. Ce qui pourrait introduire ici l’idée que la question de l’exposition est aussi fortement liée chez moi aux rapports que mes œuvres entretiennent avec l’architecture.
J’aimerais que nous fassions retour sur une des œuvres premières qui portent en elle tout le potentiel de ce que nous venons d’examiner, il s’agit dans la série des cartes postales du Promeneur (2003). Carte postale agrandie et grattée d’après le Promeneur au-dessus de la mer de nuage (1817) de Caspar David Friedrich ?
Promeneur marque la transition d’une pratique de la peinture sur châssis vers un travail de commentaire sur la peinture. Celle-ci devient le sujet. Pour effectuer cette transition, j’ai commencé par m’intéresser à la reproduction de tableaux classiques de l’Histoire de l’art sur cartes postales, puis je les ai agrandies et grattées. C’est bien le format de la carte postale qui a été agrandi pas le format du tableau car ce travail c’est aussi un questionnement sur l’uniformisation et la standardisation des œuvres via la carte postale et sur le mode de circulation des œuvres à travers ce support. Agrandir me permettait de me retrouver dans un face à face avec des peintures qui n’en étaient pas vraiment. Le geste de soustraction du papier est venu tout de suite après. Il est devenu central dans mon travail par la suite mais c’est bien de là qu’il vient…, de mon envie de continuer de faire de la peinture en abandonnant progressivement les outils et le médium du peintre.
Pour cette série et en particulier pour Promeneur je suis partie de la carte postale du Promeneur au-dessus de la mer de nuages de Caspar David Friedrich. Mon intervention a consisté à supprimer le paysage en retirant les couches de papier du tableau agrandi, comme si en même temps que je citais cette œuvre je m’en prenais au tableau lui-même (à sa reproduction bien sûr). Au milieu de la composition il ne reste que le promeneur solitaire qui nous tourne le dos. Le tableau semble être sans cadre et le personnage libéré du paysage omniprésent de la version originelle, ici il ne contemple plus rien. Le vide prend place et entame alors un dialogue avec les aspérités du mur blanc sur lequel l’œuvre est accrochée. C’est une pièce qui permet donc à la fois de travailler sur la reproduction d’un tableau et sa perception. La touche du peintre (la facture du tableau) disparaît et se transforme en une multitude de points : la trame d’impression. En retirant le papier avec un cutter, en pelant la surface qui se détache par lambeaux, j’ajoute un geste de déduction, de soustraction. C’est une sorte d’effacement du paysage par un geste plutôt que par l’emploi d’essence de térébenthine que j’aurai utilisé pour la même fin s’il s’agissait d’une peinture réelle. Symboliquement je m’attaque à la peinture, mais sans m’encombrer de sa matière, de son médium. Un peu comme si je voulais la faire disparaître dans sa matérialité même, pour travailler avec l’idée de la peinture.
La série des cartes postales grattées fonctionne également comme un jeu de reprise, je l’avais intitulée J’aurais plutôt fait comme ça pour me moquer de moi-même. C’est une tentative décalée de s’attaquer virtuellement à la grande peinture mais aussi de l’actualiser en rejouant ses codes, avec une écriture plus contemporaine et un geste radical.
Comment fonctionne la sculpture intitulée Chariot (2003)[2] que vous présentez avec ce Promeneur ?
À cette même époque j’ai réalisé Chariot une sculpture en brique qui prenait la forme d’un cadre en volume, assemblée de manière à ce qu’elle puisse s’effondrer à tout moment. C’était d’ailleurs le cas mais l’intérêt c’était de jouer avec cette tension sans qu’elle ne tombe réellement. J’ai toujours trouvé intéressant de la montrer avec Promeneur, ce personnage esseulé sans paysage. Chariot est alors le cadre manquant au Promeneur. Comme si à eux deux ils pouvaient constituer une entité et ce lien fragile entre la peinture et la sculpture. Chacun étant la part manquante de l’autre.
D’autres gestes sont récurrents dans votre travail, celui du recouvrement. Vous recouvrez des surfaces de bois avec des agrafes, de papiers agrafés, de tissu ou de la laine bouillie. Comment ces différentes couches de matériaux agissent dans votre travail, comment renvoient-ils à l’idée d’un recouvrement pictural ?
Odin, Varan, [Icône], sont des pièces faites de fragments de bois recouverts de papiers préalablement peint et agrafés. [Icône] est la première pièce de cette série. Je l’ai faite pour L’Art dans les chapelles en 2014. En visitant la chapelle qui m’était attribuée, j’ai découvert les bois polychromes du 15e siècle représentant les saints. J’ai été marquée par leur couleur, leurs dimensions. Il y eu un télescopage avec les Staccato que j’avais déjà réalisés antérieurement à l’atelier. Je me suis mise à peindre des feuilles de papier à l’acrylique et à les utiliser comme une peau picturale pour recouvrir des fragments de bois. L’agrafe est alors devenue pour moi le moyen de faire ce geste de recouvrement, ce n’est pas l’agrafage en soi qui compte, mais le résidu coloré qu’il permet d’obtenir quand j’arrache la feuille. La couleur peut aussi également être sur l’agrafe mais celle-ci est surtout un moyen pour moi d’être rapide dans le recouvrement, de poser la couleur.
Ce recouvrement dépasse donc largement le geste pictural ?
Il porte l’idée d’une protection ou d’une réparation. J’ai par exemple recouvert entièrement d’agrafes colorées les sections d’une tranche d’arbre centenaire. Plusieurs couches se superposent. C’est un geste de sublimation qui s’apparente à l’ornementation, mais c’est aussi un recouvrement qui peut être considéré comme un geste protecteur. Ces morceaux de bois sont des fragments récupérés, souvent sans usage ou destinés au rebut. Ce recouvrement, comme une écorce, est une seconde peau picturale a demandé des centaines d’œuvres de travail. L’agrafage est réalisé à la main, avec une agrafeuse manuelle, le processus est très long et le temps que je passe avec ces pièces également.
Je peux aussi faire correspondre ces pièces à une esthétique du care. La peinture et la couleur agissent aussi dans plusieurs de mes pièces comme des couvertures qui servent à protéger, à recouvrir, voire à cacher. Parfois, comme dans les portraits de la série L’Invention du courage (o salto), les recouvrements se font avec du tissu ou de la laine et font écho, encore plus directement aux recouvrements de peinture. Il suggère aussi que les clandestins qui traversaient les frontières devaient se cacher pour ne pas être pris. Par ailleurs, je viens de réaliser une pièce dans l’espace public à Vitry-sur- Seine (Pietra Paesina, 2021) qui s’inspire d’une fresque de Giotto dans laquelle un homme de la cité d’Assise couvre le sol d’un vêtement afin d’accueillir saint François et lui souhaiter la bienvenue.
Dans une série récente L'invention du courage (o salto) 2021, qui s'attache plus directement à votre histoire personnelle, vous introduisez pour la première fois des images dans votre travail. Comment utilisez-vous la peinture dans ce travail, comment dialogue-t-elle avec l'image ?
Si « o salto » signifie littéralement « le saut » en portugais, il désigne dans l’usage courant « le saut par-delà les frontières » effectué par les immigrants portugais clandestins qui traversèrent les Pyrénées dans les années 60 dans l’espoir d’une vie meilleure. Lors de ces passages de frontière, les passeurs et les clandestins avaient installés entre eux un usage particulier de l’image photographique pour garantir le bon déroulé de la traversée. C’est l’histoire de la « photo déchirée». Chaque clandestin confiait sa photo d’identité à un passeur qui la déchirait en deux. Une moitié était gardée par la famille tandis que l’autre était remise au clandestin. Une fois arrivé en France, ce dernier faisait parvenir sa moitié de photo à la personne qui avait gardé la première moitié. Reconstituer la photo permettait de payer le solde au passeur et de dire qu’on était arrivé à bon port, sain et sauf. Quand j’ai pris connaissance de cette pratique de déchirure, j’ai été frappée de la similitude avec mon propre travail plastique. Ce geste m’était familier et faisait écho à de nombreux travaux. C’est à partir de là que j’ai aussi commencé à introduire l’image dans mon travail et des photos d'identités d’anonymes, à réinterpréter la déchirure pour aller plus loin dans l’évocation de ce récit, y compris dans ce qu’il convoque personnellement.
Comment pensez-vous alors la déchirure par rapport à ces portraits et à leur histoire ?
J’ai cherché à produire des gestes qui s’apparentent à la séparation initiale de l’image en agissant sur le support. La façon dont la photo est déchirée ou cassée induit ce que je vais faire en couleur. Le bois et l’image semblent par endroit avoir été directement plongés dans la peinture. J'aime le contraste que cela produit. Certains portraits sont en partie recouverts. Cela donne des visages évanescents qui semblent vouloir s’éclipser, ou au contraire très présents. Certains sont fragmentés et d’autres entiers. Mais l’important c’est la rencontre entre le geste et l’usage que je fais de la peinture qui me permet de réinterpréter les dimensions affectives et émotionnelles de ces photographies d’identité́, et de les faire changer de statut en les transformant afin qu’ils deviennent non plus des photographies de poche sur une pièce d’identité mais de véritables portraits accrochés au mur. Comme si je souhaitais redonner à ces images d’anonymes leur lettre noblesse et dans le même temps rendre hommage au courage de ces immigrés.
Pour conclure, nous sommes tentés de revenir encore, à travers ces paroles si précises concernant le faire, sur les « formants » qui affirment la peinture dans des œuvres aux matériaux éloignés de ceux traditionnels de la peinture et aux gestes de sculpteur et constructeur tout à la fois.
S’il fallait essayer d’énoncer les éléments notionnels que porte l’œuvre d’Isabelle Ferreira ne pourrait-on pointer d’abord l’idée de cadrage ? Cadrage qui est tantôt présent et tantôt disparaissant car Isabelle Ferreira fait sortir du cadre les objets, les disperse. Pointer également la planéité qui bascule en spatialité à travers des matériaux en volume qui s’imbriquent, puis l’opération de recouvrement, en effet, tantôt des matériaux sont recouverts de peinture ou colorés à cœur, tantôt recouverts d’un autre matériau pour mettre à jour la peinture. Pointer enfin la composition qui bien que le hasard fasse partie de la démarche, est justement mise en question entre plan et volume nous imposant d’articuler autrement les différents répertoires de gestes entre peinture et sculpture.
Cette pratique hybride est donc composée, déposée, disposée, exposée ou simplement posée dans l’espace ; sur ou hors du support. Ne pourrait-on dire alors, en rappelant Maurice Denis, qu’Isabelle Ferreira ferait peinture avec des matériaux diversement colorés ou « recouverts de peinture en un certain ordre assemblés » ?
Propos recueillis par Sandrine Morsillo