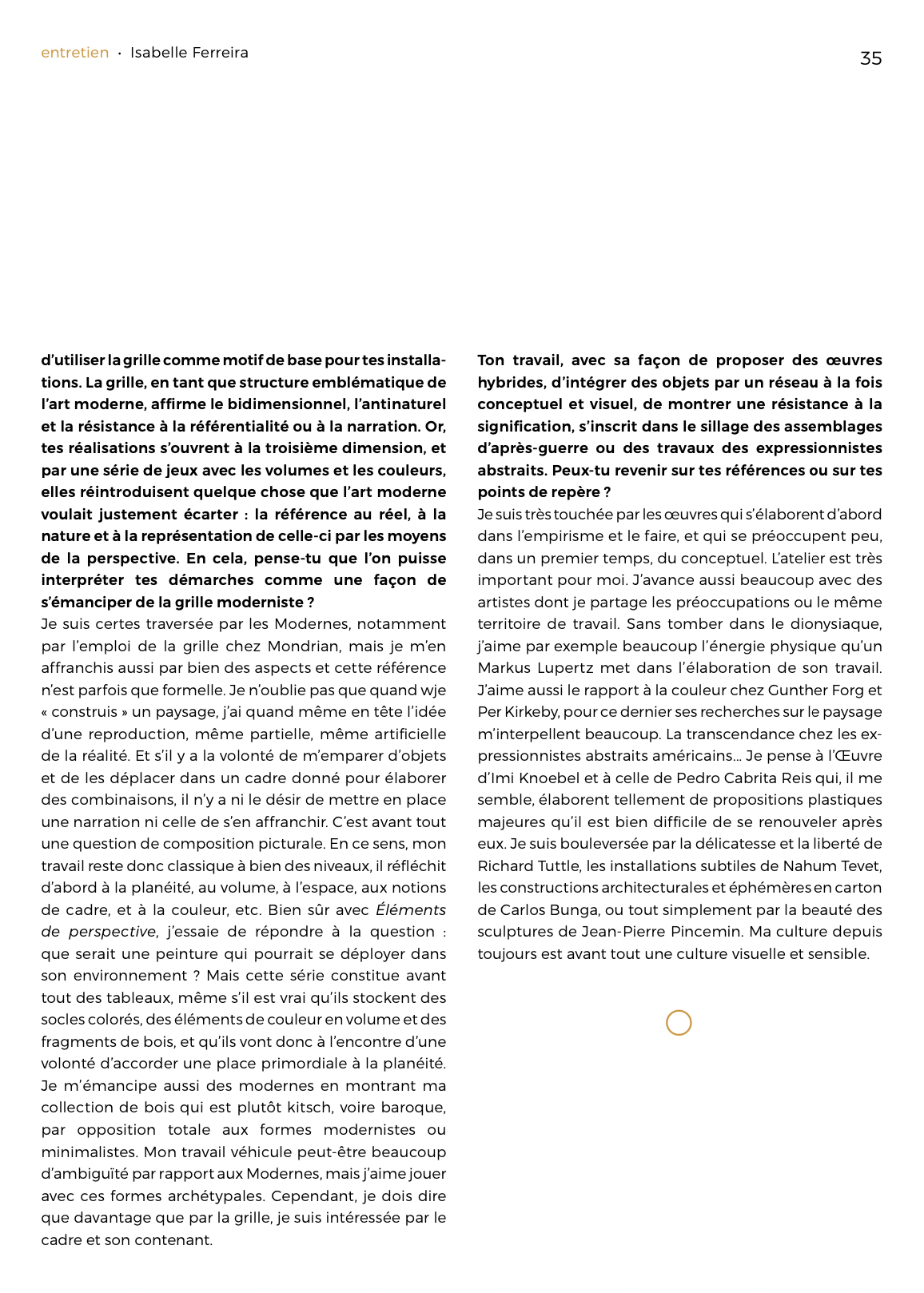La plupart des œuvres d’Isabelle Ferreira se situent à l’intervalle de la peinture, la sculpture et l’architecture. En procédant à des gestes répétés, elle remet en cause les bordures qui délimitent chacune de ces trois formes d’art tout en s’interrogeant sur la dimension historique qui les contextualise. Si les panneaux de contreplaqué, les agrafes, poutres, briques ou bois glanés servent de motifs à des expérimentations à la fois picturales et tridimensionnelles, ils participent surtout d’une restitution de paysages réels ou imaginaires ; ceci d’autant plus lorsqu’il s’agit de résonner avec les espaces qui les accueillent, qu’ils soient publics ou sacrés. L’exposition Revenir là où tout est résolu qui lui était consacrée l’été dernier à la Galerie Maubert, en nous permettant de visiter des œuvres anciennes comme nouvelles, a servi de cadre à un échange vif et éclairant.
Depuis 2012 tu travailles sur les Subtractions. Il s’agit d’une série de pièces dans lesquelles une multitude de coups de marteau est apposée de façon précise sur des panneaux de contreplaqués préalablement peints. Ce qui est étonnant est le fait d’y voir cet amalgame entre des gestes qui relèvent aussi bien de la sculpture que de la peinture. En cela, peux-tu revenir sur les différentes étapes qui permettent d’arriver à ces pièces ?
La série Subtraction est un travail initié il y a 5 ans, mais elle est surtout précédée d’une série déterminante et plus ancienne, les Wall box. Cette dernière est née d’un croisement, voire même de l’addition, d’un geste d’atelier et de mes recherches autour des territoires respectifs de la peinture et de la sculpture. Elle s’inscrit aussi dans un intérêt très ancien pour les limites du cadre, ce qui vient délimiter le tableau ; un cadre qui peut aussi devenir sculpture ou architecture en se déployant dans l’espace. Pour les premières Wall box, je cherchais plutôt à évoquer le glissement et le dialogue possible entre la planéité et le volume. J’ai alors construit de grandes boîtes en contreplaqué brut dans le but d’y enfermer de la couleur. J’ai ensuite répété plusieurs fois le geste consistant à frapper le premier plan de la boîte à l’aide d’un arrache-clou comme pour aller chercher la peinture qui avait été enfermée à l’intérieur du volume. Le résultat final était une sorte de grande béance dans la boîte qui laissait entrevoir de la matière colorée... mais pour moi c’était surtout une percée symbolique. J’utilisais un geste de soustraction propre à la sculpture pour faire de la peinture.
En somme, il s’agirait, dans ton travail, de questionner ce qui lie ou dissocie la sculpture de la peinture ? Voire même de mettre un médium à l’épreuve d’un autre ? Effectivement, mais ces pièces sont aussi nées de la volonté d’interroger le geste même du sculpteur. Il a été difficile pendant des siècles d’admettre que la sculpture pouvait être aussi noble que la peinture. La comparaison du travail du tailleur de pierre au Moyen-Âge avec celui du maçon m’a aussi orientée dans le choix des matériaux que j’utilise, qui sont propres aux matériaux du bâtiment. Faire de la peinture avec des gestes et des outils issus du bâtiment ou du bricolage m’intéresse beaucoup. C’est la question de l’usage des outils et de leurs éventuels détournements qui est en jeu. Tous ceux que j’utilise m’obligent à avoir une écriture brute (marteau, agrafeuse, cutter, bombe de peinture acrylique), mais c’est vrai aussi des gestes que j’exécute (frapper, arracher, agrafer, déchirer, tordre, compresser). C’est donc aussi une façon pour moi de questionner et niveler les catégories traditionnelles de l’histoire de l’art.
Plus précisément, cependant, pourrait-on dire qu’il s’agissait pour toi de matérialiser la peinture, de lui donner une forme de consistance, du volume ?
La série Subtraction est née quand je me suis mise à frapper de simples panneaux de contreplaqué peints, avec mon marteau. Celui-ci marque le bois avec puissance comme des touches de pinceaux en négatif. C’est un geste à la fois de soustraction et de matérialisation sur un support presque plat qu’on pourrait qualifier de volume minimum, mais qui possède une petite épaisseur quand même. Celle-ci m’intéresse beaucoup en ceci qu’elle relève a priori plus du tableau que de la sculpture. Dans un premier temps la peinture est donc matérialisée par le choix et l’usage que je fais du support en bois. La couleur est aussi importante dans ce processus, notamment par les contrastes qui se forment entre la couleur du fond restée intacte et la matière brute du support qui reste visible aux endroits arrachés. La matérialisation est donc aussi le résultat de mon geste. On pourrait dire que mon travail tente d’augmenter la peinture...ou de désépaissir la sculpture. Comme si, dans une même action, j’essayais de m’approcher au plus près de leur plus petit dénominateur commun et de trouver le point physique de basculement entre ce qui se détermine comme une sculpture et ce qui n’en est presque déjà plus une. Ces problématiques sont anciennes et continuent toujours de m’intéresser.
Les trois Subtractions que tu exposes à la Galerie Maubert utilisent le blanc et l’or. Ce sont des couleurs qui ont une forte connotation en histoire de l’art. Comment les as-tu choisies ?
J’ai été très impressionnée par les œuvres des Primitifs italiens lors de mes premiers voyages à Sienne et à Venise et puis, plus récemment, par les voûtes célestes recouvertes d’or dans les chapelles en Bretagne. Ces fonds dorés dans mes tableaux proviennent de là, de la volonté de proposer quelque chose de plus contemplatif. C’est pour cela que les dernières – Subtraction, enxame I, II, III (2017) – sont plus vaporeuses, plus atmosphériques. Depuis 2013 je travaillais plutôt à partir de monochromes colorés, mais aujourd’hui les fonds sont moins uniformes et tendent plutôt vers des paysages abstraits.
Les fonds blancs et or marqués par des gestes répétés interrogent aussi mon rapport à la transcendance. La récursivité du geste est chez moi proche d’une méditation active : il s’agit pour moi de répéter, répéter, répéter encore, mais aussi de regarder dans un second temps ce que produit sur la matière la somme de toutes ces actions.
Dans ton travail, une œuvre se développe à partir d’un geste ou plutôt d’une idée préalable ?
Il m’est difficile de répondre à cette question car les deux sont présents et importants. Cela dit, ce sont quand même des gestes qui sont à l’origine de mes premières pièces. C’est par eux que j’ai compris que j’avais des obsessions, des problèmes à résoudre. C’est le faire qui m’a ensuite amenée à poser plus conceptuellement ces obsessions, non l’inverse. Je ne suis jamais partie de rien, il y a toujours une action qui me mène à la pensée, un geste primitif et originel qui s’apparente à un coup d’essai. Presque un geste « pour rien » à la suite duquel s’organise d’autres gestes qui s’avèrent plus importants que d’autres à réactiver ou à rejouer, et qui sont aussi enclins à pouvoir rejoindre le cadre plus conceptuel de mon travail. Toute la partie qui se déroule dans l’atelier est donc très importante. Je m’astreins aussi à faire des gestes précis et efficaces - malgré leur apparente brutalité - car la plupart du temps ils ont un caractère définitif qui ne me permet pas de revenir dessus ou de les corriger. Je vais donc toujours de l’avant quand je travaille, toujours en direction de la matière avec l’obligation d’avancer en quelque sorte. En plus des coups de marteaux répétés, je travaille beaucoup avec les agrafes et parce que je recherche une certaine pureté dans le geste, je refuse d’utiliser une agrafeuse pneumatique, je préfère la manuelle, qui requiert un geste pur, un peu névrotique car il est répétitif, qui amène à un épuisement. Cela conduit à une authenticité de la forme.
La pièce [Icône] est en cela un bon exemple, je l’ai réalisée pendant L’art dans les chapelles en 2014. Quand on m’a confié la chapelle Saint-Drédeno, j’ai remarqué rapidement la présence des bois polychromes qui re- présentaient des saints et j’ai eu envie de reprendre mon geste de sculpteur en le confrontant à la couleur pour faire une pièce qui serait un martyr elle-même. Ce qui reste sur le bois après l’arrachage des papiers colorés est en quelque sorte un résidu de mon geste de sculpteur.
En parlant des Subtractions, tu évoques souvent des paysages. Une notion qui semble accompagner ton travail depuis les débuts ; en 2003 tu as agrandi Le Promeneur au-dessus de la mer de nuages de Caspar David Friedrich, en grattant les montagnes et le paysage autour du promeneur pour ne garder que la figure humaine. Philippe Nys a pu dire, par exemple, que la peinture du paysage s’articulait autour de deux pôles. Il y aurait, d’un côté, la sensation pure – et l’on songe à la peinture de William Turner ou de John Constable – de l’autre, la vision pure, avec Caspar David Friedrich. Est-ce que l’on pourrait dire que ton travail se situe lui entre ces deux pôles ?
Oui, il me semble que je navigue tour à tour entre ces deux extrémités. Par bien des aspects, le Promeneur est une pièce qui déconstruit la vision du paysage et qui met en exergue la question du sublime. La solitude face aux éléments naturels y est exacerbée par la disparition du paysage. Le personnage est plongé dans un immense vide, un presque néant puisque tout le paysage a disparu et qu’il ne contemple plus rien.
La série Subtraction, elle, serait plutôt du côté de la sensation pure. Le paysage, s’il est question de cela, serait de l’ordre de la projection imaginaire ou mentale et non de la construction d’une vision mise à distance. La composition n’est pas figurative, elle ne se fait pas avec la volonté de construire un paysage. En revanche, on peut dire que le paysage vient de lui-même quand on regarde les Subtractions, un peu comme lorsque l’on est devant les Nymphéas de Claude Monet qui sont des formes tout à fait abstraites au départ.
Aujourd’hui, je dirais que mon travail a évolué et qu’il revient d’une certaine façon aux premières expéri- mentations du Promeneur. Récemment je me suis intéressée à la construction du paysage, et même si cette construction reste très sensible avec la série Éléments de perspective notamment, l’approche du paysage (et de la peinture) est plus conceptuelle. Cette série est née de la lecture de traités réalisés à l’usage des jeunes peintres à la fin du XVIIIème siècle, comme celui de Pierre-Henri de Valenciennes. Ces traités ont été écrits pour donner à ces peintres une méthode de création de paysage, normée et artificielle. Ils regorgent de conseils pratiques afin que les artistes puissent concevoir des perspectives d’après une méthodologique préétablie. Il s’agit d’apprendre à placer un cours d’eau, une rocaille, un nuage ou une architecture. Apprendre à organiser le réel en somme.
On pourrait dire de la perspective qu’elle renvoie à la manière de disposer les choses selon des règles géométriques ; elle constituerait, en cela, la science du réel ; dès lors, dans ton travail, pourquoi abordes-tu cette question en employant un vocabulaire formel qui, a priori, semble contradictoire avec cette tradition?
Le paysage, c’est une invention de l’homme, quelque chose de totalement construit et antinaturel par définition. Donc « nature » et « paysage » sont à l’opposé et le paysage, c’est précisément l’art d’organiser cette nature sauvage. Lorsque j’ai commencé à lire les traités d’Alexander Cozens et de Pierre-Henri de Valenciennes sur la perspective, cela m’a paru intéressant de créer et de développer un vocabulaire de formes (socles peints, racines agrafées, fragments de cuivre, morceaux de bois glanés...) que j’allais pouvoir organiser moi aussi, mais à ma façon, sans dogme ou protocole. Ces organisations sont aussi des paysages artificiels, mais elles ne suivent rien à la lettre. La lecture de ces traités n’a été pour moi qu’un point de départ pour commencer à travailler et me permettre de questionner le préétabli et la composition plus sensible. Ces paysages potentiels que j’ai construits et que je nomme Éléments de perspective, je les ai traités ensuite de deux façons, a priori opposées. D’abord, d’un point de vue pictural : les éléments sont stockés dans un mobilier accroché au mur, et organisés en zones colorées, disposés de façon à créer un tableau abstrait. Ensuite, ils sont envisagés d’un point de vue sculptural, car sortis de leur mobilier et déployés dans l’espace, de manière à dialoguer avec celui-ci et ce qu’il y a autour. Le tableau du début devient alors ainsi une sorte de « paysage debout », artificiel certes, mais se confrontant au réel.
Peut-on parler d’œuvres in situ pour ton exposition car tu avais en tête l’espace de la galerie quand tu réalisais ces pièces de la série Éléments de perspective ? Éléments de perspective constituent un travail construit avec des éléments de composition créés en amont et destinés à loger à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du mobilier. Cependant, même si les pièces dialoguent avec l’espace, il ne s’agit pas de travail in situ à proprement parler. Leurs caractéristiques conceptuelles font qu’elles doivent se redéployer à chaque fois différemment, en fonction des espaces et des lieux. Les éléments restent les mêmes, mais ils sont pensés pour créer des perspectives, donc en ce sens ils jouent avec les caractéristiques de l’espace et vont « travailler » différemment selon les envi- ronnements qui les accueilleront. Par exemple un grand socle de couleur vermillon posé à différents endroits de la pièce pourra se retrouver debout ou couché, à dialoguer avec un mur blanc, un parquet, un élément architectural, ou encore une autre œuvre.
Partition (1 et 2 ; 2006), SpacioCorès (2008), dans une certaine mesure Mulhacén (2009), et plus particulière- ment Éléments de perspective (2017) ont en commun d’utiliser la grille comme motif de base pour tes installa- tions. La grille, en tant que structure emblématique de l’art moderne, affirme le bidimensionnel, l’antinaturel et la résistance à la référentialité ou à la narration. Or, tes réalisations s’ouvrent à la troisième dimension, et par une série de jeux avec les volumes et les couleurs, elles réintroduisent quelque chose que l’art moderne voulait justement écarter : la référence au réel, à la nature et à la représentation de celle-ci par les moyens de la perspective. En cela, pense-tu que l’on puisse interpréter tes démarches comme une façon de s’émanciper de la grille moderniste ?
Je suis certes traversée par les Modernes, notamment par l’emploi de la grille chez Mondrian, mais je m’en affranchis aussi par bien des aspects et cette référence n’est parfois que formelle. Je n’oublie pas que quand wje « construis » un paysage, j’ai quand même en tête l’idée d’une reproduction, même partielle, même artificielle de la réalité. Et s’il y a la volonté de m’emparer d’objets et de les déplacer dans un cadre donné pour élaborer des combinaisons, il n’y a ni le désir de mettre en place une narration ni celle de s’en affranchir. C’est avant tout une question de composition picturale. En ce sens, mon travail reste donc classique à bien des niveaux, il réfléchit d’abord à la planéité, au volume, à l’espace, aux notions de cadre, et à la couleur, etc. Bien sûr avec Éléments de perspective, j’essaie de répondre à la question : que serait une peinture qui pourrait se déployer dans son environnement ? Mais cette série constitue avant tout des tableaux, même s’il est vrai qu’ils stockent des socles colorés, des éléments de couleur en volume et des fragments de bois, et qu’ils vont donc à l’encontre d’une volonté d’accorder une place primordiale à la planéité. Je m’émancipe aussi des modernes en montrant ma collection de bois qui est plutôt kitsch, voire baroque, par opposition totale aux formes modernistes ou minimalistes. Mon travail véhicule peut-être beaucoup d’ambiguïté par rapport aux Modernes, mais j’aime jouer avec ces formes archétypales. Cependant, je dois dire que davantage que par la grille, je suis intéressée par le cadre et son contenant. Ton travail, avec sa façon de proposer des œuvres hybrides, d’intégrer des objets par un réseau à la fois conceptuel et visuel, de montrer une résistance à la signification, s’inscrit dans le sillage des assemblages d’après-guerre ou des travaux des expressionnistes abstraits. Peux-tu revenir sur tes références ou sur tes points de repère ?
Je suis très touchée par les œuvres qui s’élaborent d’abord dans l’empirisme et le faire, et qui se préoccupent peu, dans un premier temps, du conceptuel. L’atelier est très important pour moi. J’avance aussi beaucoup avec des artistes dont je partage les préoccupations ou le même territoire de travail. Sans tomber dans le dionysiaque, j’aime par exemple beaucoup l’énergie physique qu’un Markus Lupertz met dans l’élaboration de son travail. J’aime aussi le rapport à la couleur chez Gunther Forg et Per Kirkeby, pour ce dernier ses recherches sur le paysage m’interpellent beaucoup. La transcendance chez les ex- pressionnistes abstraits américains... Je pense à l’Œuvre d’Imi Knoebel et à celle de Pedro Cabrita Reis qui, il me semble, élaborent tellement de propositions plastiques majeures qu’il est bien difficile de se renouveler après eux. Je suis bouleversée par la délicatesse et la liberté de Richard Tuttle, les installations subtiles de Nahum Tevet, les constructions architecturales et éphémères en carton de Carlos Bunga, ou tout simplement par la beauté des sculptures de Jean-Pierre Pincemin. Ma culture depuis toujours est avant tout une culture visuelle et sensible.
Propos recuillis par Julia Nyikos